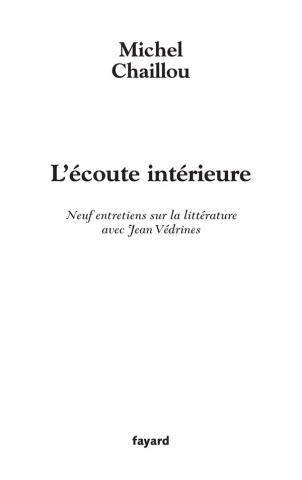L’Ecoute intérieure
4e de couverture
En neuf entretiens menés à bâtons rompus, Michel Chaillou tente (et c’est le jeu de la mémoire) de repasser, d’affûter les événements de sa vie, ses rencontres, ses amitiés, ses sympathies, ses lectures, pour essayer d’y discerner justement les graines possibles de son style (s’il en a un), d’expliquer à son interlocuteur, Jean Védrines, mais aussi à lui-même et aux autres, comment a pu naître l’écriture qui lui est propre, sa manière d’être dans les mots, ses mille façons d’y respirer, d’y vivre. Et cela grâce à une notion qu’il nomme l’écoute intérieure, une manière de poser l’oreille sur le sol de la page pour enfin entendre le mystère de ce qui survient ! Car écrire, c’est lire (cette autre façon d’écouter), mais lire ce qui n’existe pas encore. Comme lire serait pressentir ce que le style nous fait entendre inconsciemment d’une œuvre. Mais alors à quels signes sait-on qu’on a affaire à de la littérature ? Autant de questions impossibles auxquelles Michel Chaillou, dans cette autobiographie intellectuelle, s’efforce au mieux de répondre.
Extrait du premier entretien (début)
De Chantenay à la rue Lorette de la Refoulais – Le monde des illustrés – Les familles : la rue et le château – L’affaire du dictionnaire anglais – La conquête de l’Ouest avec Gustave Aymard – Les papiers dans les murs chez Maria Chapdelaine – Le premier écrit : A la manière chinoise. Les bombardements de Nantes.
Michel Chaillou, quand nous avons commencé à parler de ce livre, à nous interroger sur son cheminement – ou plutôt ses lignes de fuite – nous étions d’accord vous et moi pour refuser les contraintes d’un enchaînement trop rigoureux qui interdirait les digressions où se niche souvent l’essentiel. Rien n’aurait été plus loin de votre naturel qu’un verrouillage étroitement chronologique ou thématique. Pour autant, je vous propose d’entamer ces entretiens par l’enfance, parce que vous lui accordez une place première, qu’elle guide les pas et les mots de l’adulte que vous êtes devenu, alors qu’elle n’a vraiment pas été « un vert paradis ». Je vais donc jouer à l’officier d’état-civil et vous faire parler de votre lieu de naissance – autant dire des limbes, puisque c’est par définition un lieu d’avant la mémoire.Si je me rappelle bien ce que vous écrivez dans 1945, vous êtes né à Nantes dans une rue qui porte un nom aussi beau qu’étrange : la rue de l’Arche-Sèche.
Oui. C’est une rue du centre de Nantes, à côté de la place Royale. Le nom est assez curieux. Est-ce à cause du pont avec la rue qui passe en dessous en guise de rivière ? Pas d’eau donc, une arche sèche ! Je suis né là, au numéro 32 ou 33. Ma mère avait vingt et un ans, mon père vingt. Ils étaient un peu jeunets pour avoir déjà un marmot. Voilà. Mes véritables souvenirs commencent en fait à Chantenay, un des faubourgs ouvriers de Nantes, comme on disait à l’époque.
Un autre écrivain de l’Ouest, qu’on risque donc de croiser de temps à autre, Julien Gracq, évoque également Chantenay dans La forme d’une ville, son livre consacré à Nantes. Il y décrit son premier trajet en tramway et un paysage industriel des années trente, « une usine encroûtée de suie ». C’était un quartier peuplé de gens modestes, humbles
A Chantenay on habitait aux Fontenies, un chemin de terre que j’ai encore sous les pieds, et qui donnait dans la rue du Transvaal où mes grands-parents étaient concierges d’une papeterie. En face, habitait une sorte de maçon, en réalité un couvreur, qui tombera un jour d’un toit et qui en mourra. Et d’ailleurs il tombe toujours dans mon esprit depuis cette époque-là : je devais avoir cinq, six ans. Ce fut ma première découverte de la mort, le spectacle de cet homme inerte qu’on avait rapporté chez lui et couché dans son lit auprès du ciel immense d’une fenêtre qui m’emplit encore les yeux. Cette papeterie comprenait deux pièces sur la droite en entrant où nichaient mes grands-parents sous un toit en partie crevé (on mettait des bassines là où ça fuyait les jours d’averse), avant une immense salle où étaient installées, tapies, toutes les machines à fabriquer le papier. Le samedi, le dimanche ces monstres métalliques dormaient. J’en avais un peu peur. Je zigzaguais entre, à ma manière éperdue. A l’extrémité, un escalier en bois dévalait dans un jardin exubérant où ma grand-mère, simple paysanne vendéenne, cachait les œufs en chocolat au moment de Pâques. Et je courais pour les ramasser, en pyjama, c’est un de mes souvenirs les plus heureux. Et puis le jardin s’achevait sur un ruisselet devant un mur où ma grand-mère m’adossait souvent pour me photographier, me fusiller presque avec son appareil, tellement j’avais l’air d’un condamné contre ce mur en parpaing.
Avez-vous souvenir des premiers mots ou des premières phrases que vous auriez prononcés, à Chantenay et qui vous auraient été retransmis, comme c’est l’usage, par vos grands-parents ou par votre mère ?
J’étais, paraît-il, fasciné par une sorte de conte que je m’étais inventé, qui s’appelait La chèvre d’or, et que je me racontais à moi-même. J’ai oublié depuis les cornes de la bête et ses aventures au sabot léger. Je me rappelle aussi qu’on hésitait à m’amener au Guignol, parce que ça me mettait dans des transes incroyables. Mais tout cela, ce ne sont que des légendes familiales. Je me souviens aussi de mon grand-père lisant. Il lisait sans arrêt quand il ne travaillait pas, et surtout des livres d’histoire. Quant à moi…
Vous en étiez peut-être à ce moment de l’enfance où l’on vit, dans le jeu solitaire ou collectif, des existences parallèles, héroïques tellement intenses qu’elles sont comme un prélude aux lectures à venir ?
Sans doute que des espaces intérieurs se sont créés pour moi aux Fontenies, par exemple cette papeterie déserte le dimanche, mon grand-père qui, ce jour là, endosse ses plus beaux habits, porte des cols durs, l’escalier de bois qui gémit, la buanderie et ses bouffées de vapeur, et les étendues agricoles de nos voisins maraîchers, avec leurs plantes très éduquées, gouvernées, surveillées comme obéissant à des règles presque conventuelles, alors que les nôtres qui poussaient en pleine anarchie, en désordre, méritaient à peine leur nom propre. J’étais l’ami de leur fils et ses parents m’avaient autorisé, pour raccourcir mon trajet vers l’école, à emprunter leurs allées si bien ratissées. J’y marchais, j’imagine, sur la pointe des pieds. De ces premières années, un peu murmurantes pourrait-on dire, il me reste donc surtout des lieux plutôt que des livres – ce chemin des Fontenies par exemple, au printemps, entre des haies mûrissantes, enfin où il y a des mûres – et aussi quelques intimes tel ce fils du maraîcher, et les deux filles du maçon couvreur décédé. L’une se prénommait Marguerite et son aînée Nana, brune de la tête aux pieds, qui produit toujours la même ombre de désir dans ma mémoire. En réalité, je ne sais pas trop à quel moment j’ai commencé à lire. Peut-être dans le ventre de ma mère !
(A suivre)