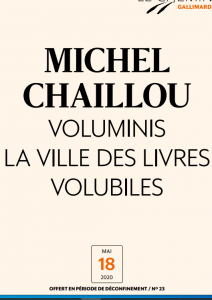Encyclopaedia universalis (Sylvie Jaudeau)
Né à Nantes en 1930, Michel Chaillou tente, par le biais d’une écriture baroque, de renouveler la technique du roman en lui annexant des disciplines ou des genres qui lui sont étrangers : histoire, géographie, théâtre. Dans cet univers romanesque, érudit et poétique tout ensemble, les lois de l’imaginaire, confondues avec le « génie » de la langue, secondent l’investigation historique. Une habile archéologie de la mémoire y rend contemporains passé individuel et passé collectif.Sous le prétexte d’une histoire de la flânerie, c’est une véritable histoire de l’imaginaire que nous propose ainsi Michel Chaillou.
(Lire l’intégralité de l’article)
Digressions
Lire la note (datée du 22 août) me concernant, et tous les autres propos du blog.
Extrait du Magazine des livres, juillet-août 2009
Vingt-cinq livres plus tard, Michel Chaillou poursuit inlassablement sa quête du temps, une recherche qui n’a rien de nostaligique. De ses phrases affleure un parfum entêtant, enivrant, qui flotte encore, longtemps après avoir refermé le livre. Grand prix 2007 de littérature de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre, Michel Chaillou revendique le démodé, qui n’est autre que « la façon dont le temps s’habille ». Mais que l’on ne s’y trompe pas : démodé ne veut pas dire hors du temps. Chez Chaillou le style est constamment réinventé. Une forme de modernisme qui fait de lui un grand classique.
Quel est le rôle de la mémoire dans votre oeuvre ?
Important dans mes récits à caractère autobiographique, moindre dans les autres ouvrages où c’est plutôt une sorte d’imagination du passé, d’un passé qui ne m’appartient pas, que j’essaie de ressusciter …
Lire la suite dans le Magazine des livres n° 18
Michel ChaillouDigression majeureMichel Chaillou n’a décidément pas changé. Rien, ni ses livres.C’est la syntaxe, qui le définit, et une façon de marcher – en langue, s’entend. C’est un promeneur : et toujours le même jardin quasiment à l’identique, mais où il déploie une fois de plus toute la littérature appelée, ses âges, ses pilotes (d’autres qui lui ressemblent).Ce n’est pas son premier livre où transparaît son expérience poitevine.Ce qu’on retrouve, dans les ombres : la mère, le Maroc,la guerre, la bibliothèque du grand-père, le vague écho manouche, les ciels d’ouest et l’art même de parler, les recoins obscurs d’une honte non sienne, mais jamais complètement finie d’être vidée, et sans laquelle il n’yaurait pas eu ce chemin qu’il a fait.La Gartempe traverse cette petite ville dont il parle,et qu’il nomme Montauvert, comme il y a un diable Vauvert. Est-ce que la force d’une histoire tient au fait qu’on reconnaisse une ville pour nôtre ? Oui, quand on a eu son adolescence ici, on ne lira pas Chaillou comme on aime, en littérature, s’en aller dans ces villes inventées, qu’elles soient celles d’Italo Calvino (Les villes invisibles) ou d’Hermann Hesse (Steppenwolf, avec le même genre de solitaire tenant journal) ou même comme Jean-Christophe Bailly avait construit son Olonne. Lycée Camille-Guérin, Poitiers, 1970 : dans ma classe d’internes, nous venions de Civray, Loudun, Saint-Maixent, Thouars… Autant de villes disposant encore de leur pleine structure complexe, d’une hiérarchie sociale aussi stable que ces vieux bâtiments qui en faisaient, souvent autour du noyau féodal, les ombres et élévations très secrètes qui servaient de lycée, de tribunal d’instance, ou que la mairie avait pu reconvertiren bibliothèque ou écoles de musique.Ce sont ces villes que la Ford Anglia du jeune enseignant ayant pris chambre à Poitiers, mais muté ici ou là, ressuscite, et nous les reconnaissons : si cela s’était appelé Montmorillon, par exemple, cela n’aurait été que Montmorillon, et non pas ce partout et nulle part qui est nous, et le hasard de notre histoire. J’aurais sans doute lu autrement ce roman de Michel Chaillou s’il s’était passé dans le Cotentin (magnifique Indigne Indigo en 2000), ou ces expéditions en voiture dans les fins fonds de France, où c’est chaque fois la littérature qu’on croise (La France fugitive, Fayard,1998, ou en poche).Mais pour nous, qui le connaissons,qui lui avons dette, Michel Chaillou n’est pas seulement un écrivain, ou bien, ce qu’il est comme écrivain, nous le projetons plus loin que le livre. «J’arrivais d’Algérie, de la guerre.»
Ce qu’il nous a apporté, c’est un déplacement de frontière. Elle est fine, impalpable : la littérature est toujours née de la littérature. Il n’y a pas de conquête possible au présent de cette simplicité d’une histoire, de ce mystère du rythme d’une prose si on ne va pas l’éduquer ou le former dans la singularité multiple qui est celle de la totalité d’une langue. Par exemple, si j’étais Michel Chaillou parlant – comme il le fait, improvisant, ayant apporté dans sa tête trois ou quatre souvenirs de livres et vous parlant deux heures avec cela –, je vous dirais par coeur la phrase suivante, sans effort, juste pour l’avoir lue et reconnue : J’arrivais d’Algérie, de la guerre. J’enseignais les lettre dans un vieux lycée pacifique à Montauvert, modeste bourgade poitevine que peuple une pauvre rivière moitié torrent qui irriguait aussi mes pensées.
Et je vous parlerais de cette mince virgule, dans le six-trois de la première phrase, et comment le mot guerre vient ronger non pas l’Algérie, probablement, mais le je initial. Et puis, dans cette phrase qui nous amène à Montauvert, qu’on découvrira sur la Gartempe, je vous signalerai comme en passant le long et doux adjectif pacifique, mais appliqué au lycée, et non la phrase qui brosse la ville comme d’une aquarelle suspendue, et sans ce déport il n’y aurait pas la liberté de résonance que prend, tout à la fin, ce mot pensées.
Combien de fois je l’ai entendu, Michel Chaillou, dans ses improvisations de conteur ? Au point que parfois elles me cachaient l’auteur : il me fallait cette présence de visage et de gestes (les mains parlantes de Chaillou) et je ne saurais jamais rouvrir par exemple le Grand Meaulnes sans que me revienne sa voix, une fois, sur«pourquoi trois, mais pourquoi trois ?» dans la phrase d’Alain-Fournier : le mystère des trois greniers. Sauf que cette strate inexplicable, parfois incohérente, signe seule les grands ouvrages, les grandes syntaxes, même dans cette chose si commune que doit être la littérature: mise en partage de ce qui nous est commun, et son interrogation devant le temps.
Un marcheur de la littérature
Le mot donc d’improvisation, pour Michel Chaillou,comme qualifiant aussi cette geste narrative quideviendra notre propre marche dans l’ouvrage, sesallers-retours et ses portraits de profs comme pris dujour, attachés à leur tâche de tous les jours et rêvantcomme un autre. Ou l’étrangeté de cette Finlandaise dans un jardin de Niort un soir de lune, et que finalement c’est de grammaire latine (mais pas seulement quand même) qu’on s’explique.
Chaillou est un marcheur de la littérature, c’est elle que d’abord il arpente. Lisez donc, si vous le trouvez,son Petit guide pédestre de la littérature (écrit avec sa compagne, Michèle – et republié chez Fayard en 2000 sous un titre que j’aime moins : La Fleur des rues). Et c’est ce «sentiment géographique» (titre d’un de ses premiers livres, en 1976), le rêve des livres emportant la déambulation réelle qui crée, d’une chose aussi simple que ranger la Ford Anglia et grimper à la chambre louée dans le vieux Poitiers, cette convocation de l’imaginaire qui nous permet que la lecture soit roman. Dans ce passage,par exemple, je l’entends d’avance, le Michel (maisi l ne commente pas ses propres livres, il vous citerait Barbey d’Aurevilly ou mille autres), vous attrapant par le bras, et chuchotant de façon à ce qu’on l’entende depuisle trottoir d’en face : «Mais comment le mot secret, àcet endroit-là, entraîne tout le paragraphe ? Essaye de leplacer n’importe où ailleurs et tu verras…»
Pour gagner mon chez-moi, il fallait d’abord pénétrerl e garage et, parmi les odeurs d’huile et d’essence, les mille bruits toujours râleurs des moteurs à explosion, emprunter tout de suite à main droite un escalier secret, quasi dérobé jusqu’au premier étage à paillasson où chancelait ma porte qui fermait mal. La pièce était vaste, tapissée d’un papier peint usagé dont j’ai perdu les figures, toutes mythologiques me semble-t-il. La chasse au cerf devait dater de plusieurs siècles, car le hallali avait manifestement gagné le papier, déchiré parle temps plutôt que par la meute à moitié effacée des chiens hurleurs. Je n’aperçois plus le coin lavabo.
Alors oubliez que ce livre roule, en Ford Anglia, sur des routes que nous reconnaissons : le monde de l’après-guerre d’Algérie n’est plus depuis longtemps. On a mis nos supermarchés et nos rocades à la place, et construitdes lycées neufs. Mais laissez-vous prendre à ce qui,chez Chaillou, sera toujours l’impossibilité du roman ordinaire : les événements, des livres. Les labyrinthes, des bibliothèques. Les adultères, les traversées du temps. Les personnages : pas forcément ceux qu’il vous montre, mais tant de fantômes qui viennent, amusés,lire sur son épaule.
(L’actualité Poitou-Charentes, avril-mai-juin 2009, n°84)
(Lire aussi l’article sur Remue-Net)
Extrait d’Un songe pourtant cadastrable » (Jacques Réda)
[…] Cette façon absolue d’envisager la littérature est un des mérites de Chaillou. La plupart des auteurs n’écrivent que pour annihiler les autres, et ceux qui plus ou moins n’ont pas cette préméditation, souvent à peine consciente et presque toujours vouée au ridicule, feraient pourtant mieux d’apprendre à jouer de l’harmonica. Mais l’ambition de Chaillou semble un peu différente. Il voudrait être tous les livres à la fois, non bien sûr dans leur multiple singularité décourageante, mais en mordant à même l’unique racine qui les alimente de son suc songeur et capiteux. Car s’il y a un rêve de L’Astrée, il doit y en avoir un qui rêve ce rêve de L’Astrée, en même temps que celui de cent mille autres bouquins. Un autre mérite consiste à ne pas se satisfaire de songer. […] En effet, élaborer une écriture qui permette d’entrer dans la substance profonde commune à tous les livres, c’est parer du même coup à tout danger d’encerclement. Voilà probablement ce qui explique la curieuse impression qu’on tire, à lire la moindre page de Chaillou, d’un mouvement qui tout à la fois s’enhardit et se dérobe, mouvement qui imprime son allure au livre pris en entier. Achevé Le Sentiment géographique, on se convainc d’avoir simultanément glissé jusqu’au fond du rêve de L’Astrée, et lutté avec un ouvrage qui ne traite jamais le sujet. Chacun à sa manière, Domestique chez Montaigne et Le Rêve de Saxe offre le même type de cohésion interne et de contrariété, un contraste encore plus tranché entre une fourmillante population de détails précis, érudits, et son but vers lequel chaque page qui dribble comme un virtuose étourdi, inspiré, s’enfonce comme dans un nuage hypnotique.
[…] J’imagine Chaillou devant sa page – pierre – nuage. Il guette, louvoie, fait marche arrière, rature, reprend, tombe dans d’insondables abîmes d’ennui, de mélancolie ou d’hébétude, puis soudain fonce (trois mots), fond comme fondent également ses métaphores qui provoquent un tourbillon d’air plein de plumes d’aigle, d’étincelles et de laine d’agneau. Ensuite ça recommence. Il n’a aucune facilité. Ceux qui, sur preuve, s’obstinent à lui en reconnaître une considérable, n’ont rien compris, et on leur conseille amicalement de se taire. On ne lutte pas au nom du facile contre une passion. Ainsi, naviguer toujplrs au plus près et s’abandonner à un rêve; conjuguer le sommeil et l’état d’éveil le plus pointu, cela revient sans doute à définir l’attitude idéale du poète, plus qu’en particulier celle de Chaillou. Mais je n’ai peu-être pas voulu dire autre chose, et cela me dispense d’une conclusion.
Extraits d »Une géographie du trouble » (Jean-Pierre Richard)
(A propos du Sentiment géographique)
Qu’est-ce que le « sentiment géographique » ? C’est, répond Michel Chaillou dans l’essai ainsi nommé, « cette évidence confuse que toute rêverie apporte sa terre », celle-ci étant à la fois son texte écrit et son pôle matériel, texte visitable comme un sol, lisible comme les pages feuilletées d’un livre. Ici, ce livre est L’Astrée, dont Michel Chaillou entame la « lecture herbagère et ce lieu le Forez, pays où depuis le fabuleux murmure des voix burgondes, jusqu’au XVIIe siècle précieux, puis jusqu’à nous, et par la médiation, entre autres, de ce genre littéraire oublié, mais apparemment si moderne, la pastorale, les bergers n’ont cessé de conduire leurs troupeaux les arbres de pousser leurs feuilles, les fleuves de couler leurs eaux, et les habitants de dormir (avec une perfection particulière, à en croire Chaillou) dans la lente rumination de ces merveilles. Ainsi se présente Le sentiment géographique, ce livre dont le charme constant ne doit pas masquer la profondeur ni sans doute l’ambition. A travers les méandres, parenthèses, repliements d’une seule longue phrase, dont le cours semble entièrement livré à l’empire de ce que Mallarmé, l’un des garants de l’aventure ici tentée, nomme le démon de l’analogie, ce qu s’invente et s’opère c’est, peut-être, une nouvelle façon de lire. Faut-il la définir ? On la dira fondée sur le principe d’une contamination, ou d’une contagion, ou plutôt d’une réversibilité générale mise en oeuvre (et sans cesse contenue, entretenue, nourrie par l’invention critique elle-même) entre les divers registres matériels, ou niveaux fonctionnels de la lecture. […]
(A propos de La Croyance des voleurs)
[…] Il y a donc dans ce roman un parler-voleur qui radicalise et théorise peut-être un certain parler-Chaillou, savoureux, toujours inimitable. De cette parole singulière, à la fois orale et raffinée, il faudrait, mais ce serait là un autre projet, reconnaître les principaux choix stylistiques, les figures aimées, la manière, unique, où une force des choses s’y lie à une « fortune des mots »,ou des « mots dans les mots », pour « dégourdir » le sens, dégeler le langage, à la manière rabelaisienne cette fois, l’y ouvrir au virtuel, à la surprise, à l’étrange. Mais à une étrangeté qui rejoint toujours un thème familier. […].
Ecriture de la cambriole encore, où les mots se mettent à courir (à voler) parce qu’ils sont de multiples manières (c’est la rhétorique) déviés, détournés de leur usage ordinaire. Et ce dévoiement rejoint une duplicité foncière du désir : « J’avais parlé voleur à Ellen, un langage double, à triple fond ? Du vrai en même temps que du faux, des phrases à grande poche. On y glisse ce qu’on veut. » Il y a ce que le langage sait, et aussi comme dans l’étagement d’une pyramide, ce qu’il ignore, ce qu’on découvre brusquement en lui, ou en nous.
Lire Chaillou, c’est vider à chaque moment cette « grande poche » d’écriture; c’est déverser sur nous le plein de sa besace, sa corne d’abondance.
Extrait d' »Un livre de sommeil » (Jacqueline Risset)
On peut rêver de livres qui sortent du sommeil comme d’un bain, portant encore sur eux son essence, ses gouttes, sa rosée. Mais peu d’écrivains, peu de personnages ont le courage de s’abandonner ainsi au sommeil qui anime et relie par liens d’herbe ce qui nous importe. Comme une seule phrase glissant insensiblement sur une surface horizontale et molle. Il s’agit du sommeil et du rêve ensemble, sans que le rêve domine: du sommeil et du rêve vus par la littérature, la littérature vue comme un usage plein, épanché, de la langue, en ce cas de la langue française – cette langue d’eau, cette langue glissante et transparente, émerveillante et sommeillante. Le Sentiment géographique, de Michel Chaillou, parcourt à la fois la plaine de Loire et les pages qui ouvrent les six mille de l’Astrée, en liant et fondant leurs composantes comme le font le sommeil et le rêve.
Voluminis la ville des livres volubiles est le n°22 de la toute nouvelle collection de courts textes en ligne « Le Chemin continue » créée en avril dernier chez Gallimard par l’éditeur Alban Cerisier en hommage à la célèbre collection de Georges Lambrichs « Le Chemin ». Une contribution hautement symbolique puisque c’est au Chemin qu’est paru le premier roman de Michel Chaillou, Jonathamour.